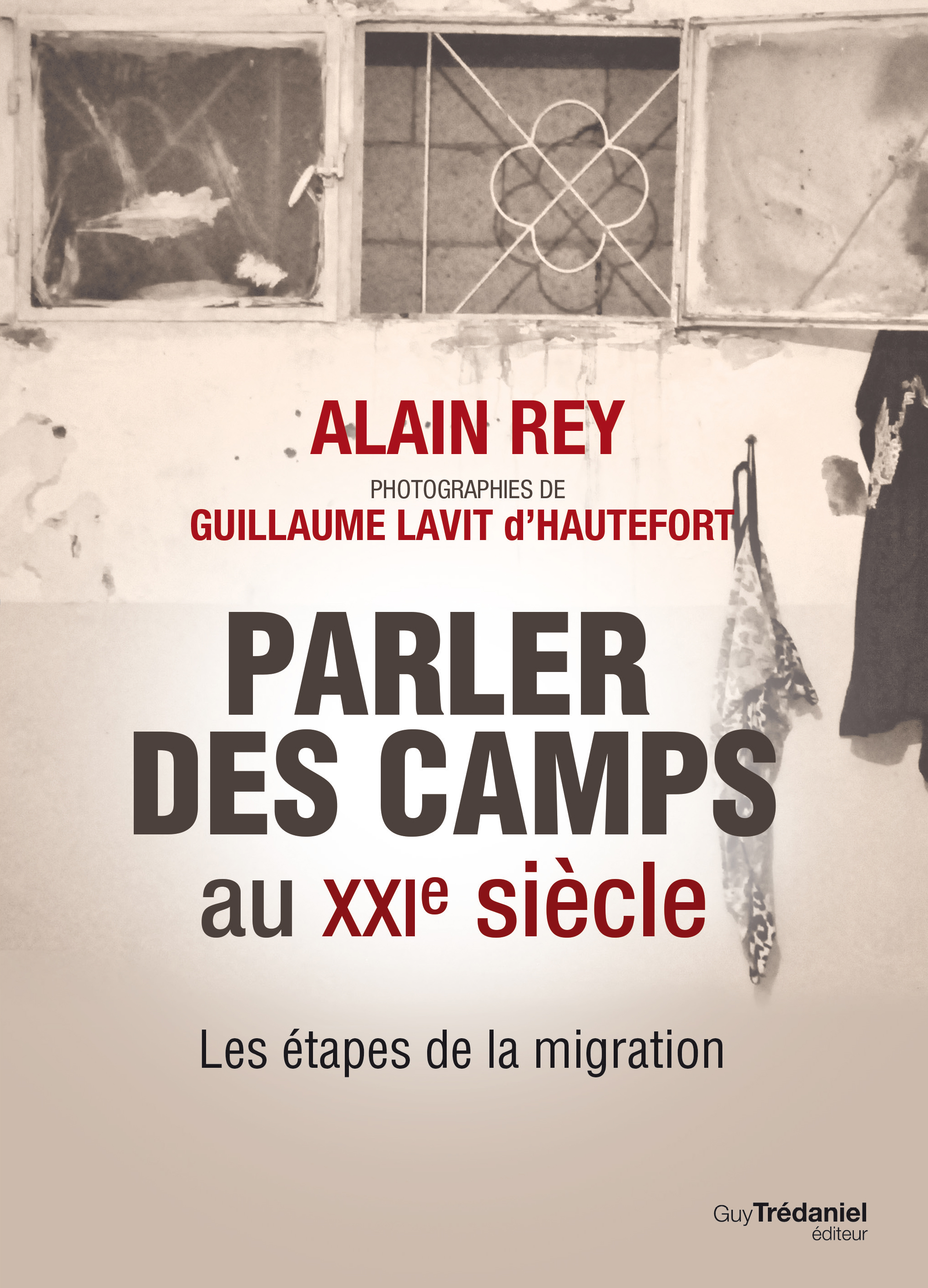Alain Rey a sélectionné quelques bonnes feuilles de son livre, Parler des camps au XXIe siècle, aux éditions Tredaniel, à découvrir ci-dessous.
Dans "humanitaire", il y a "humain". Des femmes, des hommes, des enfants dans des situations différentes, mais toujours dures, de la menace de mort au quotidien difficile. Parler de ces situations devenues caractéristiques d'une époque en termes généraux, par l'abstraction du langage, ne suffit pas.
Heureusement, l'instant du réel saisi par l'objectif du photographe fait réapparaître la vérité particulière à chacun, vérité d'apparence, témoignage du visible. Au-delà, l'humanité, les consciences, les pensées, les sentiments, les douleurs et parfois le plaisir de vivre. C'est-à-dire le vécu, le ressenti des migrants, des exilés, des déplacés, des réfugiés, des êtres
humains dont le statut est défini de l'extérieur et par contrainte.
Des consciences humaines qui sont poussées hors des cadres naturels de la vie collective, la famille, le groupe, le clan, la tribu, l'ethnie, hors des cadres sociaux, la nationalité, la profession, les croyances religieuses, la sensibilité politique, et qui sont forcées de survivre dans cette construction artificielle, à la fois abri et prison, qu'est le camp, et de fuir ou de se cacher, d'être la proie des divers exploiteurs du désastre, passeurs, "marchands de sommeil", employeurs illégaux.
Prétendre évoquer l'infinie variété des vécus, des ressentis humains, dans ces deux situations extrêmes que sont l'exil, la fuite, la recherche du supportable et, en cas d'asile, la transformation de l'attente en quotidien durable, de l'espoir en résignation, du provisoire prétendu en durée de vie..., cela relève peut-être d'une illusion, lorsqu'on n'a pas vécu ces situations.
Mais en s'appuyant sur le regard-témoin de Guillaume Lavit d'Hautefort, sur les histoires humaines qu'il fournit, on peut tenter de reprendre les divers aspects de l'expérience des migrants, exilés, réfugiés ou déplacés, en essayant de respecter leur épaisseur humaine irremplaçable.
Ce qui conduit à éclairer ces situations autrement que par les classifications issues du réel pour le rendre compréhensible ou pour pouvoir agir sur lui. Les chapitres précédents, et d'abord celui qui concerne "les personnes", peuvent (et doivent) être repensés en termes d'expériences vécues, de désespoirs et d'espoirs, d'énergie de survie, de danger et de mort, parfois aussi de résilience, d'idées pour changer les choses ou pour s'accommoder de l'inévitable, parfois, heureusement, de volonté et même de plaisir de vivre, grâce aux valeurs de la famille, de la solidarité.
À l'évidence, ce ressenti humain diffère selon le sexe, l'âge, l'origine, l'activité antérieure tout autant que selon les situations immédiates. Les migrants et les peuples des camps ont tous un passé, des souvenirs -souvent terribles- qui peuvent les aider à surmonter un présent fait d'incertitude ou de résignation, et toujours d'une frustration organisée, d'une violence exercée au nom de la solidarité humaine, entre bienveillance, courage, hypocrisie, rejet, dénégation, hostilité, indifférence, mépris... de la part des stables, des tranquilles, des bien nourris, après la violence pire née de la misère et de la haine, et qui détruit mondialement le normal au profit du pathologique.
Le départ et la recherche: être migrant
On a vu au chapitre 2 à quel point la notion et le mot de migrant pouvaient renvoyer à des situations humaines différentes. À quel point, dans l'expérience vécue, le fait de relever d'un statut officiel ou d'un autre était secondaire. Ces statuts, ces catégories, écrit Michel Agier, "sont des masques officiels posés provisoirement sur les visages qu'ils cachent".
Cette phrase ne peut que toucher quiconque s'intéresse aux mots et au dire, par rapport au réel. En effet, les terminologies créées par les normes sociales, le droit, les institutions, l'action politique sont des masques rigides, parfois des faux nez. Quant aux bons vieux mots du langage quotidien, ici migrant, étranger, clandestin, ils n'ont pas ce dessin précis qui pourrait en faire de faux visages ; ce sont plutôt, avec leurs ambiguïtés, leurs incertitudes, leurs contradictions, des voiles, des paravents, qui laissent deviner les vrais visages et les corps.
C'est que les premiers, masques de fer du pouvoir dominant, ne sont que des êtres de raison, des "classeurs" ("Penser, classer", disait Georges Perec), des échappés des langues naturelles, vaguement internationaux, alors que les mots du quotidien, gonflés d'affects, imprégnés de l'inconscient collectif qui commande les idiomes de Babel, conservent l'attirance humaine qui gouverne l'amour et la haine, l'identification qui conduit à la compréhension, ou bien, tristement, l'indifférence et le mépris par méconnaissance et préjugé. Lorsqu'un francophone, en 2015, entend ou lit, prononce ou écrit le mot migrant, ce n'est pas une abstraction froide, un masque administratif, mais un fait humain, des femmes, des hommes, des enfants perdus, éperdus, des malheureux entassés dans des rafiots improbables, des noyés par milliers, une "mère Méditerranée" devenue folle et criminelle, Médée assassinant les enfants des autres. Migrant, c'est aussi étranger à la peau sombre -proie de xénophobie et de racisme- qui vient quémander, tenter d'envahir la douillette Union européenne ou l'Amérique du Nord, qui erre dans les environs de la bonne ville de Calais, qui ennuie les touristes des îles grecques, qui désespère l'Italie.
On s'attendrit, on vilipende les États et toutes les institutions qui "ne font rien", qui "laissent faire", on utilise la peur, après l'avoir suscitée, tout en faisant couler les larmes d'hypocrisie qu'on attribue légendairement aux crocodiles.
Derrière ces affectivités, ces élans et ces réticences collectives, des réalités, des chiffres. En juillet 2015, 100.000 entrées illégales de migrants dans l'Union européenne. Peu de chose à côté du flux mal comptabilisé: 160.000 tentatives d'entrée en Grèce de janvier à août 2015, plus qu'en Italie, où se trouve, à l'écart, le camp témoin dramatique de Lampedusa. Des routes balisées par la rapacité meurtrière des "passeurs" (beau mot devenu ignoble), de l'Algérie et du Maroc vers l'Espagne, de la Tunisie vers l'Italie, de la Turquie vers la Grèce. Y transitent, après des Afghans, des Érythréens et, de plus en plus, des Syriens (4 millions de personnes ayant fui l'étau des terrorismes, celui d'un État criminel et celui de l'islamisme "califal"). Pour ceux qui tentent de gagner les pays du sud de l'Union par voie maritime, la traversée sud-nord se solde, entre 2000 et 2014, par 22.400 morts, par noyade en général.
Chiffre dénonciateur, monstrueux quand on le compare à d'autres tragédies mortelles de l'émigration, les 6000 morts mexicains cherchant à entrer aux États-Unis entre 1996 et 2013, par accidents ou violences, les 2000 noyés ou victimes de pirates dans la baie du Bengale... Et encore, ces chiffres ne concernent que les victimes recensées, et ignorent des milliers de disparus. Avant d'évoquer maladroitement le vécu de ces migrants si divers, il faut noter l'hypocrisie de la plupart des pays d'"accueil" ou d'"asile", trahissant ces mots. On prétend, en France, distinguer des "réfugiés politiques", qu'on accepte, et des "migrants économiques", qu'on veut rejeter, comme si la menace de mort par famine et misère était une fiction, comme si la torture, la prison, le service armé imposé, l'épidémie n'étaient pas le lot des ressortissants de ces chers États-nations qui ont leur siège à l'ONU, lorsqu'ils ont le malheur d'hériter d'un régime totalitaire.
Quant aux États démocratiques, leur attitude est fonction de circonstances géographiques plus que de bonnes ou de mauvaises volontés politiques. La Grèce et l'Italie, en 2015, supportent une pression telle qu'une solidarité internationale est indispensable à leur égard. L'Allemagne semble plus lucide que d'autres États européens. Ayant accordé 203.000 demandes d'asile en 2014, l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (en allemand BAMF) prévoit 400.000 demandes pour 2015.
Le raisonnement de Michel Agier et de François Gemenne, qui condamne les fermetures de frontières et les "murs" artificiels et finalement inutiles (on pense à l'asphyxie de la Palestine par le mur israélien, à la frontière matérialisée entre Mexique et États-Unis, qui n'a aucunement freiné l'émigration mexicaine, ou entre Maroc et enclave espagnole), consiste à rappeler que les flux migratoires sont commandés par des causes extérieures et qu'il est absurde de vouloir agir sur eux par la contention après qu'ils sont déclenchés. Les commerces humains des "passeurs" sont d'ailleurs favorisés par ces fermetures, qui font monter les tarifs de passage.
Dans la mesure où le contrôle et le blocage aux frontières empêchent la circulation dans les deux sens, ils empêchent les migrants établis dans un lieu d'étape (comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, pour ceux venus du sud et de l'est) d'aller plus loin, mais aussi de revenir en arrière si les circonstances changent.
Les études économiques, enfin, montrent qu'un statut légal confère aux travailleurs étrangers non seulement une sécurité accrue, mais aussi la possibilité de contribuer à la prospérité du pays d'accueil et, par l'envoi d'argent au pays d'origine, à améliorer des situations dans ce dernier. Mais ces considérations rationnelles pèsent moins que les fantasmes et les peurs, savamment exploités par une partie du personnel politique des pays riches.
Quel peut être le vécu d'une personne chassée de chez elle par la violence d'une situation collective ou par celle de la nature, entraînant deuil et famine? On peut distinguer des situations types, mesurer la force de ce désir d'échapper au pire qui conduit à acheter de l'espoir, celui du "passage", auprès de commerçants d'êtres humains, évoquer cet espoir sous forme d'une destination idéalisée, comme celle qui jette dans les impitoyables "jungles" de Calais ou de Grèce, par la fascination d'un paradis britannique rêvé, comme celle qui conduit Syriens et Érythréens vers une Union européenne crue sans frontières et sans polices. Mais comment tenir compte de l'essentiel, qui oppose le sort d'orphelins migrants à celui d'enfants partageant la fuite de leur mère, celui de jeunes et de vieux en relative bonne santé à ceux qui peuvent craindre tout autant la mort qui vient du dedans que celle qu'imposent les circonstances? Comment mesurer, dans les consciences, la tempête entre des souvenirs insupportables, des espoirs fous et un présent plein de dangers?
Il faut bien pourtant, au nom de l'humanisme le plus élémentaire, admettre que des causes désastreuses forcent des êtres humains à fuir, à chercher asile et refuge, et à ne trouver, après l'angoisse d'un voyage au bout de la nuit, que le néant de l'indifférence, ou bien d'autres maux: travail contraint, "rétention"...
Un cas où l'institution du camp associe confinement et activité forcée est celui du camp de Kofinou, à Chypre, étudié par Olivier Clochard. C'est administrativement un "centre d'accueil" où des demandeurs d'asile, souvent africains ou palestiniens, dans un lieu isolé, croupissent sans jamais obtenir le statut de réfugié. En diminuant les aides et en autorisant l'accès à ces migrants sans papiers au marché du travail, dans des secteurs peu appréciés par les travailleurs chypriotes, les autorités ont en fait intégré les gens du camp à un bassin d'emplois précaires, économiquement bénéfique aux employeurs locaux. Le demandeur d'asile, malgré les lois, est alors devenu un travailleur agricole, le camp servant de manière très discrète de fournisseur d'emploi avantageux pour l'économie de l'île.
Ainsi, le migrant, en principe mâle et adulte, en instance de refuge, regroupé -faut-il dire concentré?- dans un camp ou un campement, peut-il être considéré à la fois comme une menace et une source de profit dans l'univers capitaliste triomphant (l'ex-univers prétendu socialiste ayant pratiqué une exploitation sous forme de bagne). Dans l'histoire du mot camp, la spécialisation qu'exprime l'expression camp de travail s'est incarnée en droit pénal (les bagnes) et en institution de violence totalitaire. La mutation de 1945, faisant disparaître l'univers "concentrationnaire" ainsi nommé par David Rousset, a produit une nouvelle planète de rétention, non pénale, où le travail, producteur de plus-value, n'a pas été oublié. L'économie capitaliste, au XIXe siècle, avait par exemple créé des lieux réservés aux travailleurs des mines (les corons, en France) et à ceux des usines. Dans les pays colonisés ou exploités par des États ou des entreprises, existent des lieux de travail séparés, contraignants, où une organisation autarcique permet parfois à l'employeur de récupérer par des systèmes de vente ou de prêt inéchappables une partie des salaires versés.
Le régime de travail en dortoir, inspiré en partie de l'armée, en partie de la prison, a pu aboutir dans plusieurs pays à un système économique intégré au développement, à l'urbanisation et à la gestion des migrations de la campagne vers la ville. Le cas de la Chine socialo-capitaliste est connu.
Un tel système correspond à la multiplication de nouveaux "camps de travail", labour camps, tels ceux qui logent les travailleurs venus de pays ou de zones pauvres dans des régions en développement, sur de grands chantiers. Les entreprises d'Amérique du Nord en ont créé en Amérique latine, les États colonisateurs puis les grandes multinationales, en Afrique. Entre 1920 et 1930, la compagnie pétrolière Aramco introduit le labour camp dans les pays du Golfe. Ces émirats, riches, ambitieux, peu peuplés, sans main-d'oeuvre, en ont fait leur profit, et l'on peut penser que des zones en développement rapide, en Asie et en Afrique, ont pu adopter ce modèle.
En évoquant le ressenti quotidien des travailleurs venus d'Asie du Sud dans un de ces camps, au Qatar, Tristan Bruslé apporte une contribution précieuse au thème du vécu des camps, spécifique de la situation d'hommes séparés de leur famille et de leur patrie par la nécessité, et placés dans une situation où tout, logement, rythme de vie, ségrégation par rapport à la société réceptrice, est imposé par la collusion entre le pouvoir étatique et les intérêts et les nécessités économiques. Le travailleur étranger, toléré mais écarté, caché, parqué, est en même temps indispensable pour le projet politico-économique.
Or, l'expérience vécue, provisoire mais de longue durée de ces travailleurs en camps, peut être dans une large mesure généralisée à tous les "encampés". Elle se caractérise par un
effort constant pour aménager une situation pénible d'ennui, de confinement, de promiscuité, de contrainte globale mais aussi par une liberté, toute relative, pour rendre moins invivable un quotidien sinistre et lent. Les Népalais de ce camp y travaillent par contrat de deux ans, renouvelable ; la plupart s'imposent deux contrats.
On peut imaginer qu'à part les sédatifs psychologiques que sont la télévision, les ordinateurs et les portables, c'est la perspective d'un retour dans sa famille qui rend le quotidien supportable. Bien que la décision de travailler dans un tel camp soit dictée par la violence économique et non par un risque immédiat et mortel, bien que le statut du travailleur en camp soit légal, la pesanteur d'un temps militaire ou carcéral, la mise à l'écart, la vie en un non lieu associent le vécu de ces hommes à toutes les populations contraintes de vivre dans ces sortes d'espaces.
Car, on l'a vu, la "forme camp", matériellement variable, relève d'une même pathologie historique. Certains lieux, points de chute ou d'interruption dans cette fuite mal encadrée qu'est la migration, sont exemplaires. En Europe, une étape de "premier secours et d'accueil", instituée en 1998 et connue dans le monde entier dans les années 2010, est enserrée dans l'île minuscule de Lampedusa, entre la côte tunisienne et la Sicile. Ce camp provisoire pour migrants illustre à lui seul l'ambiguïté des politiques: sauver, mai en isolant, secourir, mais en enfermant, à la fois accueillir et éloigner, gérer dans une discrétion proche du secret. À Lampedusa comme ailleurs, la "sûreté" policière accompagne la "sécurité" retrouvée; à Lampedusa plus qu'ailleurs, "le sauvetage en mer constitue aussi une arrestation et [...] les premiers secours se combinent à la détention".
Indépendamment des paradoxes juridiques entretenus, ce lieu "humanitaire" était devenu inhumain pour les migrants retenus. Le témoignage accablant du journaliste Fabrizio Gatti a suscité de fortes réactions en Italie, mais des améliorations relatives et momentanées aux modalités matérielles de cette mise en camp -et donc du ressenti quotidien des migrants venus de Tunisie, de Libye- ne diminuent pas le caractère symbolique et dénonciateur de ce lieu où l'assistance humanitaire est envahie par la logique quasi pénale de la rétention.
Lorsque les migrants échappent à la mort -par noyade, maladie, accident- et aux nombreux centres de rétention, zones d'attente et autres dispositifs sécuritaires, ils peuvent
échouer dans ce qu'on appelle une "jungle", mot d'abord utilisé à Calais pour l'abri "sauvage" de migrants cherchant à atteindre la Grande-Bretagne, ensuite appliqué à des lieux similaires. Ces campements spontanés offrent à leurs habitants une vie précaire, entre abris en forêt et squats urbains, hors de tout statut légal. Périodiquement interdites et détruites, ces jungles manifestent le scandale du traitement réservé aux migrants, et le manifestent autrement que les centres de rétention du genre de Lampedusa.
Les migrants n'y sont pas enfermés, mais écartés et abandonnés, secourus très insuffisamment, souvent par initiatives associatives, et périodiquement chassés des abris qu'ils se sont ménagés. Dans les deux situations, les conditions de vie -alimentaires, sanitaires, de logement- sont déplorables et les tentatives pour y échapper (à Calais, passages clandestins sous des camions) causent des accidents mortels. Les migrants sont des hommes jeunes, ayant traversé plusieurs pays, du sud au nord et de l'est vers l'ouest (surtout des Afghans, des Érythréens et d'autres Africains) pour échapper à une violence répressive, celle de régimes totalitaires comme celui de l'Érythrée, ou au chaos meurtrier des guerres civiles.
Dans l'été 2015, certains parmi ces migrants pénètrent sur les voies ferroviaires d'Eurotunnel, interrompant le trafic. Très peu de temps après, un projet d'accord entre la France et la Grande- Bretagne prévoit de débloquer des crédits pour remédier à cette fâcheuse situation. Migrants oubliés, écartés et ignorés, mettez en cause une grande comptabilité, et les pouvoirs vous percevront.
Lueurs d'espoir, cependant, dans cet enfermement dehors, la compassion, la solidarité obstinée de quelques-uns, et les relations humaines forcées, parfois tendues mais souvent chaleureuses et solidaires que créent les détresses partagées. Les cultures, les religions intimes -comme ces abris plus soignés que les autres qui sont les tentes-mosquées, l'islam étant la croyance dominante pour les exclus des "jungles"-, les souvenirs mêlés des Afghans, des Africains, comme ailleurs, ceux des Palestiniens et des Syriens, des Soudanais et des Tchadiens, créent, dans la douleur, des liens nouveaux, hors des États, tous et diversement coupables, hors des patries -un monde d'apatrides volontaires, dans la nostalgie schizophrène des groupes communautaires.
Vivre et mourir en camp
On vient de le voir, les lieux d'exclusion et de rétention, qu'il s'agisse des camps officiels, des errances qui peuvent y conduire, des campements sauvages ou des dortoirs de travailleurs étrangers, de clandestins ou de migrants fichés et surveillés, relèvent d'une même problématique mondiale, où le matériel humain du désordre global est traité, selon le sociologue Zygmunt Bauman, comme le sont les déchets de la civilisation postindustrielle. Gênants, encombrants, à détruire systématiquement (on n'ose plus le dire, après la Shoah), ou alors à écarter, à cacher, à isoler (et c'est, par exemple, la nakba, la "catastrophe" palestinienne) et, après 1945, à gérer internationalement, mais dans le concert des États nations.
Or, les plus puissants parmi ces États ont fini, avec la menace atomique, par renoncer aux violences périodiques que furent les "guerres mondiales" -par peur du désastre planétaire-, ont fait en sorte d'exporter, par un impérialisme mal dissimulé, la violence dans les pays les plus pauvres. Les camps, on peut en effet les considérer comme des usines-dépotoirs, comme la déchetterie des ressources humaines. Mais en même temps, par cette résilience indestructible qui corrige la misère de la condition humaine, s'y opère un mystérieux recyclage, qui fait apparaître, dans la difficulté et le malheur, les germes de nouvelles identités, dans le hors-jeu de l'économie, tyran du monde, dans le hors-l'État, comme on dit hors-la-loi.
Le vécu quotidien du peuple des camps a été prévu, balisé, organisé pour pouvoir les gérer. On a évoqué plus haut les conditions générales de ces activités humaines nécessaires, être à l'abri, protégé des intempéries, pouvoir dormir, manger et boire, se laver, se soigner. Pouvoir s'installer "sain et sauf", deux états que certains lieux de ce monde ignorent. Tout a été prévu pour cela, dans les camps de réfugiés du HCR, dans les camps de déplacés, mais rien n'y est accompli convenablement, suffisamment. La distribution et la répartition des vivres, de l'eau, le combustible pour se chauffer, les médicaments, les soins aux enfants et aux malades, la protection des plus faibles, autant de causes de difficultés, de désordres et de tensions. La situation générale est de mal-aise, d'insuffisance et de précarité.
L'homme et la femme, et l'enfant, ne vivent pas seulement de pain, l'eau étant plus essentielle encore; ils vivent ensemble, en société, ils vivent d'eux-mêmes et de leurs proches, ils vivent d'amour et meurent de haine. Le camp tend à reconstituer les conditions d'une vie commune "normale", villageoise ou urbaine.
Comme on le voit dans ce livre, à Gouroukoun, au Tchad, on est entre soi; on tend à retrouver le village; à Chatila, au Liban mais loin de tout pays réel, on a rêvé aux villages perdus; le camp y a substitué une ville étrange. L'espace s'est resserré, les fenêtres ouvrent sur des murs, dans ce pays de soleil, on vit sous lumière électrique, les maisons ont grandi, le parpaing a remplacé la hutte, puis la toile de tente. Parfois, le camp-campement et le campvillage sont en effet devenus des quartiers, des banlieues, parfois des ghettos, ailleurs des bidonvilles...
Parler des camps, comme parler des villes, c'est surtout parler des êtres humains qui y vivent. En communiquant, en se parlant -et pour cela, il faut passer la barrière des langues et des dialectes, fabriquer des signes, plier les habitudes-, les peuples des camps se constituent, mais aussi se déchirent. Car discuter, c'est parfois s'affronter, et l'histoire des camps, reproduisant cette grande Histoire dont Hegel disait qu'elle était le tribunal de ce monde, décidément grand coupable, est pleine d'oppositions: de préjugés, de délires religieux et mythiques, d'intérêts contraires. Car, dans les camps comme dans toute société, interviennent l'intérêt, l'"économie" (mot terriblement dévoyé), le "commerce", terme ambigu.
De la nécessité absolue pour survivre, consommer, devant l'insuffisance, parfois l'inadaptation et l'artifice des aides, assumées par des pouvoirs aussi lointains, capricieux et incompréhensibles que les dieux antiques, renaissent les besoins et les moyens de toute société, la solidarité et ses contraires, avidité ou avarice, le recours à l'échange, au troc, puis la confiance mise dans les signes : la monnaie, la pièce ("l'argent") et le billet, et le compte, et la banque, avec ces activités, acheter, vendre, exploiter les envies, en créer de nouvelles, commercer... Ce qui, outre la satisfaction de besoins, crée du lien social et banalise un quotidien fait d'espoir et de résignation, de rares plaisirs et de beaucoup de gênes, d'ennui et de rêves.
Les situations objectives sont connues; leur ressenti ne peut l'être que par des témoignages, récits ou images, comme celles que l'on voit ici, effets d'un regard de familiarité sans nulle sensiblerie ni recherche d'effet, celui de Guillaume Lavit d'Hautefort, qui a vécu à Gouroukoun, Tchad, qui y témoigna pour les déguerpis, qui a fréquenté les Afghans de la jungle calaisienne, qui a des amis vivant à Chatila, qui a assisté à la débâcle chaotique du régime de Kadhafi...
Chatila, précisément, camp mythique, témoin historique de la mutation de cette nouvelle réalité planétaire. Chatila est passé, matériellement, de la tente au campement, du campement à la ville. Dans le vécu des Palestiniens qui y furent installés par les instances internationales, on est passé du provisoire et de l'espoir d'un retour au passé -le village, le clan, ses familles- à l'installation résignée et durable. Ce camp emblématique est allé de l'un à l'autre par le drame. Hala Abou-Zaki, dans un article de synthèse publié dans Un monde de camps (op. cit., p. 35-46), montre que l'histoire de Chatila, inscrite dans celle de la diaspora palestinienne (Liban, Jordanie, Syrie...), est nettement divisée en quatre époques: création internationale et gestion libanaise, de 1949-1951 jusqu'en 1970; "jours de révolution" (ayyam elthawra) et présence de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), de 1969-1970 à 1982; période de l'invasion israélienne et de conflit interne libanais (1982-1990), avec les massacres des populations de Sabra et Chatila par les milices de BachirGemayel, qui venait d'être assassiné, et avec la bienveillance des troupes israéliennes (septembre 1982).
Chatila est alors devenu un symbole de la cause palestinienne, et "jusqu'à la fin des années 1980, massacres, perquisitions, emprisonnements et sièges rythment la vie des habitants du camp" (Hala Abou- Zaki, op. cit.). La responsabilité de ces violences passe du Liban à la Syrie en 1985, année où commence la "guerre des camps" proprement dite. Pendant le siège de 1986-1987, plus de 700 encampés sont tués ou blessés; à la fin de ce siège, Chatila est détruit à 85%. L'année suivante, la lutte fratricide entre le Fatah d'Arafat et le Fatah-Intifada d'Abou Moussa achève la catastrophe. Chatila renaît pourtant en 1990, par la volonté politique du Liban: maintenir les réfugiés palestiniens sur place, et le "camp" s'accroît, par le relogement des habitants d'autres camps détruits et par d'autres déplacés (libanais) et réfugiés (syriens) économiques, puis politiques, pour les Syriens. Chatila est devenu une sorte de banlieue pauvre de Beyrouth, faite de logements à bon marché, objet de spéculations immobilières, où une moitié de la population est palestinienne, l'autre formée de Libanais et de Syriens (certains d'origine palestinienne). De nombreux habitants sont nés dans cette ville-camp et n'ont pas de souvenirs directs de la Palestine, qui reste symboliquement très présente; de même, selon H. Abou-Zaki, subsiste la nostalgie du village originel face aux dangers moraux de la grande ville.
L'histoire de Chatila est comme un miroir des situations historiques troublées de la mondialisation: urbanisation, refuge économique et politique, lieu de violences et de victimisation, situations d'exil, transition entre l'espoir de retour à un passé perdu (ni âge d'or ni paradis perdu, qui sont pour les mythes, car on est ici dans le réel impitoyable de l'histoire). Elle met en scène dramatiquement, puis concrètement, le grand dilemme de toute personne en camp: vouloir partir, revenir, "retourner" ou bien s'accommoder, finir par se sentir chez soi, finir par vouloir rester dilemme commun aux peuples des camps, des banlieues pauvres, des favelas..., dilemme pour les migrants et clandestins-, le "camp" pouvant alors être une ville, une région, un pays. Cette histoire sera peut-être celle des campements et des camps provisoires qui tendent à durer; elle dépasse de loin les conditions locales de son déroulement; elle illustre le fait qu'il n'y a pas de communauté humaine sans rêve, sans conflit, sans drame, sans invention d'un avenir possible, sans révolte et sans révolution, au moins virtuelle.
En effet, la psychologie sociale des camps peut osciller de la résignation à la révolte, du statut de victime, qui est forcément celui des camps de survivants d'une catastrophe naturelle (Haïti, la Louisiane, le Sud-Est asiatique) ou des irradiés après un accident nucléaire (Tchernobyl, Fukushima), à celui de revendicateur, réclamant soit un retour, soit un changement de statut politique, par nationalisme, volonté d'identité collective niée. Or, l'espoir d'obtenir un statut nouveau peut s'associer, dans l'univers des camps, à la volonté de s'approprier collectivement un espace, d'y habiter.
Les mots eux-mêmes enseignent qu'habiter est plus et autre chose que s'abriter, que se loger. L'habitant n'est pas seulement un sédentaire; en français du Canada, c'est ce qu'on nomme en France un paysan, l'être humain qui s'est approprié, avec des semblables, un "pays". Le verbe habiter vient d'un dérivé latin de habere, qui a donné avoir (haber en espagnol, avere en italien, apparentés aux have et haben germaniques). Mais habere a des racines profondes et évoque une relation multiforme avec l'espace : un espace humain fixé, qui associe l'appropriation d'un lieu et une manière d'être stable. Habere marque non seulement l'ancrage, le fait de rester, la stabilité physique, mais aussi celle de la situation globale, psychique, sociale (d'où l'idée d'habitude), celle de la manière durable de se tenir et de paraître (d'où l'habit), celle de la bonne adaptation, dans l'appropriation de l'environnement (d'où l'idée d'habileté).
En français, habiter, habitation et habitant prennent leur sens actuel au Moyen Âge, entre le XIe et le XIIIe siècle, mais habitat est récent: comme migration, il concerne tous les vivants, animaux et humains. L'histoire du verbe habiter illustre la richesse de ses possibilités; au xvie siècle, habiter une situation (par exemple, la guerre), c'était s'y trouver durablement; habiter avec quelqu'un, c'était fréquenter, et même avoir des relations sexuelles; habiter un lieu, le peupler; dans le domaine psychique, des sentiments, la paix, Dieu lui-même "habitaient" l'âme.
Stabilité et possession durable; maintien et pensées maîtrisées, aptitude à tenir le réel, l'espace, sinon le temps, tout cela est derrière cette situation banale: habiter un lieu. Les humains placés, forcés, concentrés dans les camps, parfois, forment le projet de les "habiter" réellement, complètement. Car, en les y plaçant, on leur a refusé d'habiter véritablement cette planète. D'étape militaire instable -on dit encore en camp volant-, puis de lieu d'enfermement et de mort, le camp est donc devenu au XXIe siècle lieu d'asile forcé, et d'exclusion, et de rétention. Pour l'"habiter" vraiment, il va bien falloir le transformer, se l'approprier. Vue de l'esprit? Pas forcément, car on observe, dans l'histoire générale du phénomène, des évolutions imprévues, et qui n'étaient pas imprévisibles.
Tout d'abord, dans les tensions entre le peuple des camps, ces migrants indésirables, ces déplacés, et les gestionnaires lointains et proches, qui peuvent aboutir à des tentatives d'autogestion, au désir de passer d'une vie imposée, assistée, subie, à une vie réglée par des lois internes, avec des hiérarchies et des institutions propres. Les échecs locaux du HCR, les difficultés rencontrées par les ONG ne sont pas rares.
Et surtout, il arrive que la politisation ne débouche pas sur de nouveaux conflits (comme ce fut le cas pour les camps palestiniens), mais dessine des situations nouvelles. L'autonomisation des camps, cependant, reste limitée par le besoin d'assistance; elle s'inscrit dans un processus de transfert de pouvoir à celles et ceux qui n'en ont aucun, appelé en anglais empowerment.
Même sans aboutir à une prise de pouvoir, la diminution de l'oppression de minorités ou de peuples sans État a pu être obtenue par l'existence de camps-témoins, tels que la chaîne des camps des Karens, peuple de l'est de la Birmanie, établis en Thaïlande le long de la frontière (voir Alexander Horstmann, "Mae La [Thaïlande]. Humanitaire, nationalisme et religion dans les camps karens [...]", dans Un monde de camps, op. cit., p. 86 sq.), ou dans les camps d'Algérie, près de Tindouf, où les Sahraouis réfugiés du Sahara marocain contrôlent une "préfiguration" d'État, une République arabe sahraouie démocratique créée en 1976, revendiquant ce Sahara occidental occupé par le Maroc (et, dans un premier temps, par la Mauritanie).
Là aussi, les camps sont passés de campements de tentes peuplés de femmes et d'enfants, les hommes combattant pour le Front Polisario, à de petites villes de cases et de tentes. Manuel Herz en décrit les apparences et le fonctionnement, étonnants par rapport à l'idée générale qu'on se fait du "camp de réfugiés": en plein désert, une sorte de gouvernement autonome en exil, autogéré, qui combine l'habituelle économie d'assistance subie (l'aide venant surtout du Programme alimentaire mondial) au troc et à une économie financière née de retraites accordées à des travailleurs par l'ancienne puissance coloniale, l'Espagne, et par des envois d'argent de Sahraouis travaillant en Algérie ou ailleurs. Une véritable politique urbaine, de santé, scolaire - avec des ministères spécialisés -, du commerce, des activités sportives. Mais la psychologie sociale du camp, faite d'exil et d'attente, reste vivante pour préserver l'objectif: récupérer un territoire pour une nation sédentarisée, et aujourd'hui, par les camps, semi-urbanisée.
D'autres minorités et peuples sans État, les Kurdes, par exemple, dans le nord de l'Irak, avaient géré, sans les camps, une autonomie et une stabilité remarquables ; mais le pseudo-califat terroriste de Daesh en a contraint beaucoup à peupler des camps au Kurdistan turc. Le peuple kurde, entre l'oppression d'Ankara, la violence de Daesh et celle de Bachar el-Assad en Syrie, a des camps l'expérience inverse de celle des Sahraouis: celle du désespoir.
Alain Rey - Parler des camps au XXIe siècle - Ed. Tredaniel
VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST